[ ... ] Si maintenant nous cherchons le modèle sur lequel ont été calqués cet office et cette image d'Enki/Éa, autrement dit ce qui y correspondait en la société mésopotamienne ancienne - comme le roi y a fourni le diagramme du détenteur surnaturel du pouvoir sur tout l'univers : ci-dessus p. 257 -, peut nous mettre sur le chemin un mythe assez mal connu celui des apkallu *, calculé pour répondre
à la question : comment Enki/Ea, « inventeur » de la civilisation et des techniques, les a-t-il insérées dans l'histoire et révélées aux hommes ?

Ce mythe ne nous est pas conservé comme tel et d'une teneur : il nous faut en partie le reconstruire. Nous en devons tout d'abord le propre canevas à Bérose *, ce « prêtre babylonien de Bêl * » qui, vers 300 avant notre ère, a résumé en grec la « philosophie » et l'histoire de son très vieux pays.


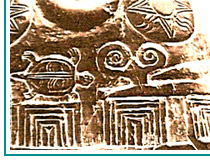
|
En Babylonie, nous explique-t-il, quantité d'hommes venus d'ailleurs s'étaient
installés en Chaldée (partie de la Basse-Mésopotamie attenant au golfe Persique), où ils menaient une existence inculte, pareils à des bêtes. Une première année, alors, apparut ... sur le rivage un monstre extraordinaire sorti de la mer Rouge et appelé Oannès. Son corps entier était celui d'un poisson avec, sous la tête, une autre tête insérée, ainsi que des pieds, pareils à ceux d'un homme - silhouette dont on a préservé le souvenir et que l'on reproduit encore de notre temps. Ce même être vivant, passant ses jours parmi les hommes, sans prendre la moindre nourriture, leur apprit l'écriture, les sciences et les techniques de toute sorte, la fondation des villes, la construction des temples, la jurisprudence et la géométrie; il leur dévoila pareillement la culture des céréales et ta récolte des fruits; en somme, il leur donna tout ce qui constitue la vie civilisée. Tant et si bien que depuis lors on n'a plus rien trouvé de remarquable ( sur ce chapitre ). Au coucher du soleil, ce même monstre Oannès replongeait en la mer pour passer ses nuitées dans l'eau : car il était amphibie. Plus tard apparurent d'autres êtres analogues ... , sept en tout, que Bérose nous décrit ailleurs comme également issus de la mer Rouge et ichthyanthropes, et qu'il rattache chacun à l'un des règnes antédiluviens 1.

Bérose est un auteur toujours digne de foi; et, dans la tradition littéraire sumérienne et akkadienne, on relève aisément plus d'un trait qui recoupe son énarration ou y laisse entrevoir une tradition vénérable. Un court récit mythique, inséré dans un exorcisme 2, fait allusion à sept brillants apkallu, qu'il compare à des carpes, parangon de splendeur et d'éclat, dans l'imagerie poétique du cru, et qui ont assuré le succès des plans divins tirés pour le ciel et la terre. De son côté, la célèbre Épopée d'Erra * 3 évoque également les sept apkallu de l'Apsû, carpes saintes, qui, pareils à Éa, leur patron, avaient recu ( de lui ) en partage une ingéniosité extraordinaire. Un autre document, une liste d'époque séleucide 4, énumère seize personnalités, rattachées chacune au règne d'un souverain,
_________________
1.
|
P. SCHNABEL, Berossos, p. 253 S.: III.
|
2.
|
E. REINER, The Etiological Myth of the " Seven Sages ", Orientalia, N.S., XXX, 1961, PP. I-II.
|
3.
|
Mythes et rites de Babylone, p. 233, vers 162.
|
4.
|
H. J. LENZEN, XVIII. vorläufiger Bericht über die ... Ausgrabungen in UrukWarka, I962, PP. 44-52 ( J. VAN DIJK).
|

auprès duquel chacune semble avoir joué le rôle de ces sages, traditionnellement placés, en Orient, à côté des rois, comme conseillers, et que les Arabes appelaient leurs « vizirs ». Elles sont réparties en trois subdivisions : la dernière, qui en compte huit, remonte du règne d'Asarhaddon ( 680-669 ) au Déluge, et leur confère le titre d'ummânu; la seconde, au temps du Déluge, et la première, auparavant, en alignent également huit, ensemble, mais les appellent apkallu. Tout se passe donc comme si les apkallu n'étaient que les ummânu du temps mythique : diluvien et antédiluvien. Or, le mot akkadien ummânu se réfère à des personnages d'un certain calibre et qui peuvent être tout ensemble des sages, des lettrés ( certains de ceux que mentionne la susdite énumération nous sont connus par ailleurs comme écrivains et « auteurs », par exemple, l'un de l'Épopée d'Erra, l'autre de l'Épopée de Gilgames * ), mais aussi des gens de métier particulièrement compétents chacun en sa spécialité : dans un pays où l'usage purement spéculatif de la réflexion et de l'esprit était pratiquement inconnu et où savoir et intelligence se trouvaient finalisés par la réalisation et la réussite, le cumul de ces notions sur un même vocable n'a rien de surprenant. Les ummânu en question étaient donc à la fois des sages conseillers du roi et des façons de superexperts à son service, comme nous en avons par ailleurs, en Mésopotamie même, quelques exemples édifiants — tel, pour n'en citer qu'un, Mukannisum sous le roi de Mari Zimrilim ( vers 1780 ) 1. Les détenteurs du pouvoir, comme tels et sauf exception, n'avaient guère pu être initiés, en leur jeune âge, à l'immense domaine du savoir, de la connaissance des problèmes techniques, dont le rôle était pourtant considérable dans une société aussi « industrielle » et vouée à la production et à la transformation des biens utiles selon des procédés traditionnels efficaces hautement développés : la présence auprès d'eux de tels experts était donc indispensable, et le mythe a pris aux souvenirs de l'âge historique cette figure de l'ummânu, sage célèbre, esprit profond, connaissant tout, pouvant trancher de tout avec justesse et sagacité, souvent promoteur ou inventeur de techniques nouvelles, pour la transposer dans le temps mythique, en lui conférant seulement une auréole encore plus éclatante, qui se trahit dans la désignation d'apkallu sorte de superlatif sumérien d'ummânu. Supertechniciens, sages incomparables, génies fameux, ils ont été considérés comme les héros civilisateurs, ceux qui ont enseigné aux hommes, encore frustes, tout ce qui constitue la vie civilisée, comme s'exprimait Bérose, lequel précisait : l'écriture, les sciences et les techniques, catégories que les Grecs et nous-mêmes distinguons beaucoup mieux qu'on ne le faisait en Mésopotamie, où l'on n'y voyait d'abord que des procédés traditionnels efficaces, sans donner tant de poids au fait qu'ils requéraient principalement l'usage des mains ou de l'esprit.
_________________
1.
|
O. ROUAULT, Archives royales de Mari, XVIII.
|

Ces apkallu sont donc rattachés à Éa, leur patron, et le premier d'entre eux est surnommé Adapa, le Sage ( p. 296 ), dont le nom connu par la liste séleucide plus haut résumée, était précisément U'anna: Oannès. Éa s'est servi d'eux pour introduire la culture dans l'histoire de son pays: les grands progrès techniques, les éléments successifs de la haute civilisation qui avaient fait de la Basse-Mésopotamie, puis de Babylone, le pôle culturel du monde. Ici encore, nous sommes incapables d'isoler les réminiscences historiques fossilisées dans le mythe des apkallu. Du moins voyons-nous clair comme le jour, non seulement qu'il illustrait aussi, à sa
façon, l'idée que l'on s'était faite d'Enki/Éa, inventeur de toutes les commodités de la vie, de toutes les techniques, de toute la culture, qu'il avait peu à peu apprises aux hommes, avec le temps, par ses envoyés extraordinaires, les apkallu; mais également qu'il supposait d'eux à lui de profondes affinités.

Précisément, l'un de ses titres traditionnels, que lui avaient conférés la dévotion ou la théologie ( et qu'il a du reste transmis à son fils Marduk ), était akal ilî 1 : l'apkallu des dieux,
ce que nous nous garderons bien de traduire, comme on le fait couramment : le plus sage des dieux, mais, au pied de la lettre : celui qui, entre les dieux, joue le rôle d'apkallu, autrement dit : celui qui se trouve placé, comme un « vizir » intelligent, subtil, sage conseiller, aux ressources inépuisables, auprès du souverain des dieux, lequel sans lui n'aurait su faire toujours bon usage de son pouvoir — l'histoire du Déluge était là pour le démontrer ( voir p. 269 ). Son office était différent de celui du gouvernement — et c'est pourquoi les deux ont été hypostasiés en deux personnalités distinctes; mais il en était le complément indispensable — aussi le mythe les a-t-il juxtaposés. À côté de l'autorité, du pouvoir, du commandement efficace, de la prestance, il fallait sans faute la vue claire et profonde, l'intelligence, la sagesse, pour donner un sens positif à ces ordres — c'est ce que l'on peut appeler « la fonction technique du pouvoir », éminemment incarnée dans Enki/Éa.
_________________
1.
|
Voir notamment Chicago Assyrian Dictionary, A/2, p. 171 s.
|

Une telle disposition souligne d'abord avec force combien le système des dieux n'était, en Mésopotamie, que la traduction et le reflet de l'organisation sociale, économique et politique des hommes ( déjà, notamment, p. 256 s. ). À ce point que si cette dernière, mieux connue, peut nous aider à entendre plus d'un recoin obscur de la théologie, où elle se retrouve, les développements de la théologie, à leur tour dûment analysés et pénétrés, éclairent bien des aspects de la pratique ou de l'idéologie qui commandaient la vie en commun et la façon de voir des antiques habitants de ce pays. Rien, par exemple, ne nous permet une plus vive aperception de la forme qu'ils avaient donnée à la souveraineté, que leur mythologie du pouvoir divin ( ibid ).

De même, l'image d'Enki/Éa, et la mise en avant de ce qu'elle représentait, nous introduit-elle, mieux sans doute que toute autre considération, à la vision que ces vieilles gens avaient de leur propre culture, à leur hiérarchie sociale des valeurs et jusqu'à leur propre façon de concevoir et de priser l'activité de leur esprit.

Ce n'est point le dieu de la Guerre, ou celui de la Justice, dont ils avaient flanqué inséparablement leur souverain de l'univers, mais le dieu de la Technique : pour eux, du reste, guerre et justice, nous l'avons vu dans Inanna et Enki ( p. 287 s. ), n'étaient que des moyens, parmi d'autres, de mieux vivre, des procédés traditionnels efficaces pour obtenir sécurité et prospérité — des techniques.

S'ils ont élu le dieu qui les commande toutes pour présider, côte à côte avec son souverain, à la marche de l'univers, c'est parce que — mille traits de leur mythologie et de leur histoire nous le démontrent — la civilisation entière de leur pays, toute leur vie et leur manière de vivre étaient fondées d'abord, depuis la nuit des temps, sur le travail en commun, la production et la transformation extensive de biens utiles. Dans un pareil système, tout est commandé, en définitive, par une activité de l'esprit, qui recherche, invente, promeut, perfectionne des procédures, non pas tant pour mieux voir que pour mieux faire. Toute la connaissance, toute l'intelligence se trouvaient donc polarisées par la production et l'action, se réalisant aussi bien dans le « jugement
pratique » de l'artisan, ce que nous appelons « le métier », que dans la sagacité et la capacité d'adaptation du tacticien, et le « bon sens » et l'astuce de ce que l'on connaissait autrefois, en français, sous le nom de « prud'homme » — tant sur le plan collectif que de la réussite individuelle.

Dans ces conditions, il était comme inévitable que le dieu où s'était incarné ce type de sagesse dont la forme la plus parfaite était constituée par la connaissance-technique-qui-réussit-toujours, fût mis au premier rang, juste après le suppôt du pouvoir souverain sans lequel il n'y aurait pas eu de vie sociale possible, et que sa fonction fût présentée comme le parachèvement de ce pouvoir. Et ce dieu n'était pas un « ancien », un « vieillard », comme Anu, le patriarche de la dynastie divine, à qui l'on aurait bien pu songer, après tout, pour lui confier le rôle de conseiller : c'était un dieu plus jeune, Éa — comme pour insister sur sa capacité, non seulement de lumières, mais d'action, de rapidité et de souplesse, aussi indétachables de la « fonction technique » que de la « fonction de gouvernement », qui composaient la double face du pouvoir. [ ... ]
_________________

Apkallu
|
Désignation d'origine sumérienne ( le sens précis en est inconnu ) des sept « Sages », héros civilisateurs envoyés par Enki/Ea enseigner la culture aux habitants archaïques de la Mésopotamie ( p. 297 s. ), et dont le premier était U'anna/Adapa.
|
Bérose
|
Lettré babylonien qui, peu après 300, a mis en grec l'histoire et les traditions de son pays.
De ces Babyloniaka, il ne nous reste que des lambeaux, fort précieux vu le sérieux de leur auteur ( pp. 172, n. 1 ; 297 s. ).
|
Bêl
|
Mot akkadien qui signifie « le Seigneur » et s'entend de Marduk.
|
Erra
|
Autre nom de Nergal. Il était le héros d'une large composition d'environ sept cents lignes, sur cinq tablettes, appelée Poème ou Épopée d'Erra, dont un tiers environ est perdu. Écrit sans doute aux alentours de 850, il expliquait les malheurs de Babylone, et sa résurrection, par la volonté destructrice d'Erra, finalement apaisée. Voir p. 298 s.
|
Gilgames
|
Nom sumérien ( de signification incertaine ) d'un roi « d'Uruk », au second quart du IIIe millénaire, très vite devenu le héros d'un certain nombre de légendes en sumérien, et plus tard divinisé ( p. 330, n. 1 ). Le contenu de la plupart de ces légendes a été repris en akkadien et rassemblé en un récit suivi, d'une grande vigueur et d'un réel souffle poétique : c’est ce que nous appelons l'Épopée de Gilgames. Y étaient contées les prouesses de ce dernier, avec son ami Enkidu, sauvage acculturé, et comment, après la mort prématurée de ce dernier il s'était mis à chercher le moyen de vivre sans fin, puis était revenu chez lui, bredouille. L'état sous lequel nous connaissons le mieux cette œuvre est celui que nous a fourni d'abord la Bibliothèque d'Assurbanipal : nous l'appelons l'édition ninivite, en onze tablettes et dont il nous reste à peu près les trois quarts ( 233 s. ). Des fragments plus anciens ( notamment ceux « de Pennsylvanie », « de Meissner », etc. ) donnent à croire qu'il a pu exister une ( ou plusieurs ? ) version(s) ou édition(s) paléo-babylonienne(s) de l'œuvre ( p. 141 s. ). Plus tard, l'on a ajouté à l'ensemble, en une « Xlle tablette », la traduction akkadienne d'une des légendes en sumérien : Gilgames, Enkidu et l'Enfer ( p. 264 ).
|
_________________

|